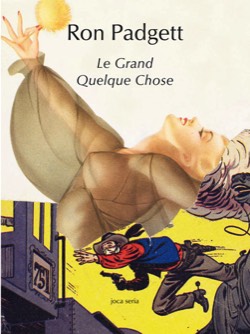Il est le poète réel qui se cache derrière les poèmes de Paterson le chauffeur de bus de Paterson, héros du film éponyme de Jim Jarmush.
Ron Padgett est publié à Nantes par les éditions Joca Seria.
Il était venu lire les poèmes de son premier recueil publié en France en 2010.
Place publique lui avait alors demandé un texte sur son séjour nantais.
Celui-ci avait été publié dans le numéro 22 de la revue (aujourd'hui épuisé).
Nous vous le redonnons.
Nantes,
ce mystérieux collage cinétique

« Comment en vient-on à connaître une ville ? » n’est pas une question à laquelle beaucoup d’Américains songeraient. Sans doute est-ce davantage une question que les Français se posent et c’est celle que je me suis posée à Nantes. J’imagine qu’elle est dans l’esprit du « que sais-je ? » de Montaigne bien que je n’aie rien d’un philosophe. Je suis poète et je suis venu à Nantes pour faire une lecture et pour y rencontrer mon éditeur pour la première fois.
*
Bernard Martin dirige les éditions joca seria à Nantes. Dès que je l’ai vu, j’ai eu l’impression de déjà le connaître, car il ressemble comme deux gouttes d’eau à Edward, le secrétaire de mon orthodontiste à New York : même physique, même gestuelle, même façon de prendre les choses avec humour. D’ailleurs, Bernard est l’incarnation vivante du nom de sa maison d’édition et ce n’est peut-être pas un hasard qu’il se soit si bien entendu avec les poèmes de mon livre.
*
Il y a dix ans, j’ai eu l’occasion de rencontrer Olivier Brossard qui travaillait au service culturel de l’Ambassade de France dans le cadre de son service national (quel service !). Nous sommes tout de suite devenus amis et nous voilà, dix ans plus tard, avec sa traduction d’un de mes recueils de poésie, Le Grand Quelque Chose dont nous allions lire des extraits à Nantes.
*
Que savais-je de Nantes ? Deux ou trois choses, comme dirait Jean-Luc Godard. Je savais qu’Olivier avait étudié là-bas, que le proto-surréaliste Jacques Vaché s’y était suicidé et que lorsque l’on prononce « à Nantes » avec un accent américain on obtient « an aunt », une tante en anglais. Donc, parce que nous sommes amis avec Olivier, parce que j’ai été influencé par les surréalistes (pas au point de me suicider cependant !) et parce que j’ai toujours été proche de ma tante, j’aimais Nantes avant même d’y arriver.
*
Et j’ai aimé la ville bien davantage encore quand, vers 14 heures, je suis arrivé à l’hôtel Pommeraye dont la réceptionniste fut très accueillante ; quelques instants plus tard, je déambulais dans le magnifique Passage Pommeraye qui m’a rappelé le Passage Choiseuil à Paris, où je suis allé à plusieurs reprises en 1966 à la recherche de livres de Raymond Roussel, un autre écrivain très admiré des surréalistes. Place du Commerce, je me suis arrêté à un café pour manger un morceau et demander quelques renseignements sur le tram. Je savais que je pouvais aller au musée des Beaux-Arts à pied, mais j’aime prendre le tramway. Le garçon, plutôt aimable, m’a donné des instructions dont j’ai découvert ensuite qu’elles n’étaient en fait pas très fiables, mais, un peu plus loin dans la rue, une serveuse d’une incroyable gentillesse, son plateau d’assiettes sales à la main, a pris son temps pour m’expliquer, d’abord en français puis en anglais, tout le système du tram. Je n’ai jamais rencontré de serveuse aussi patiente en France.
*
Un ami artiste à New York m’avait dit qu’il y avait deux ou peut-être trois belles toiles au musée des Beaux-Arts de Nantes, et un autre ami m’avait dit que c’était un bâtiment magnifique : j’avais donc décidé d’y faire une visite d’une trentaine de minutes. A l’accueil, la chance a continué de me sourire : un jeune employé très cordial – il n’est tout de même pas possible que tout le monde soit aimable à Nantes – m’a demandé mon code postal, et quand je le lui ai donné, « 10003 », il a semblé perplexe, jusqu’à ce que je lui explique que c’était « celui de New York ». « Ah, New York. Cela doit être merveilleux là-bas. Je ne suis jamais allé aux États-Unis. » « Vous devriez y aller, et pas seulement à New York. C’est un pays immense et très divers. » Son regard s’est alors éclairé : « Hollywood ! » Ma destination à moi était moins lointaine : je voulais voir les œuvres du Pérugin à l’étage. Le jeune homme m’a indiqué l’escalier que j’ai commencé à gravir quand j’ai entendu sa voix alors qu’il me suivait pour me dire : « Monsieur, j’ai oublié de vous informer que si vous voulez aller au 19e siècle, vous tournez à droite en haut de l’escalier et à gauche si vous souhaitez voir les siècles précédents. » Il y a des gens aimables aux États-Unis mais je doute que j’y aurais reçu autant d’attention.
*
Puis, nouvelle surprise : mon ami artiste si bien informé avait tort. Deux ou trois beaux tableaux ? J’en perdais le compte : trois du seul Pérugin, surtout son Saint Sébastien, trois de Georges de la Tour (dont un sans sa chandelle de prédilection), le portrait de Madame de Sennones d’Ingres (qui rappelle la Dame à l’hermine de Léonard de Vinci à Cracovie), un tableau de jeunesse de Watteau, maladroit et plein de charme, et plusieurs toiles étonnantes d’artistes dont j’ai oublié de noter les noms. Et puis il y a les lieux, ces pièces hautes de plafond, aux proportions gracieuses et à la lumière généreuse. Et comment pourrais-je oublier la grande statue du gorille suscitant la crainte comme le sourire. J’ai tout de suite imaginé son oncle King Kong grimpant tout en haut de l’Empire State Building, chassant les avions comme si c’étaient des moustiques. (Je n’ai pas vu un seul insecte à Nantes. Étaient-ils tous partis en vacances avec les étudiants ?) J’ai jeté un œil à ma montre : il était déjà quatre heures et quart.
*
L’emploi du temps de la journée étant serré, je ne suis pas descendu voir la collection d’œuvres modernes, ce que je regrette maintenant, ayant appris qu’on peut y voir des œuvres de Gaston Chaissac à qui Serge Fauchereau a consacré un livre charmant. J’ai donc poursuivi mon chemin vers ma seconde destination, le château. J’adore les châteaux. De l’extérieur. Quelle que soit la splendeur de leurs salles, j’ai le sentiment qu’elles renferment des siècles d’oppression : mobilier extravagant, tapisseries passées de scènes de chasse et la pensée terrifiante (pour moi) de tous ces sybarites coiffés de hautes perruques se promenant accompagnés de leurs reflets dans les glaces. J’ai donc fait un tour dans la cour puis sur les remparts, goûtant la tranquillité des lieux dans la fraîcheur de l’air et la chaleur du soleil. Puis je me suis vite mis en route vers ma troisième destination, la cathédrale.
*
Ces derniers temps je me suis plongé dans la lecture de L’Automne du Moyen Âge de Jan Huizinga et des œuvres de Maître Eckhart, et tout ce qui touche à la fin de la période médiévale m’attire au plus haut point. Comparée à celle de Reims (que j’ai esquissée en 1972 en me servant de mon café en guise de peinture) ou Chartres (que j’ai visitée en 1966 avec mon ami le peintre George Schneeman dont le collage est en couverture du Grand Quelque Chose) ou au duomo de Milan (que mon fils qui vivait en Italie m’a emmené voir il y a vingt-cinq ans), la cathédrale de Nantes n’est pas spectaculaire mais, lorsque je m’y suis assis et ai regardé en l’air, j’ai soudain eu la vision d’une foule hissant de gigantesques blocs de pierre, très lourds, parfaitement taillés, au cœur d’un capharnaüm aérien d’échafaudages pour les mettre en place et les cimenter, si bien qu’une fois de plus je me suis émerveillé du pouvoir de la chrétienté et de la persévérance de ses fidèles, et je me suis imaginé un instant parmi eux, ces visages couverts de la poussière des pierres, ces bras médiévaux meurtris. Cela voulait dire qu’il était grand temps d’aller prendre une tasse de thé et un pain au chocolat.
*
À 18 h 30, le téléphone a sonné dans ma chambre d’hôtel. C’était le très ponctuel Bernard qui était arrivé pour me conduire au lieu de la lecture. Olivier est arrivé au même moment et nous sommes tous partis en voiture pour nous rendre de l’autre côté de la rivière, dans un quartier qui m’a d’abord semblé un endroit assez improbable pour une lecture de poésie. J’ai en fait appris que c’était là que se trouvait le Palais de justice conçu par Jean Nouvel (à moins qu’il ne s’agisse d’une fourrière) mais aussi IDM et Tetrarc, les cabinets de design et d’architecture dont le nouveau bâtiment, imaginé par Michel Bertreux, semblait avoir reçu une volée d’innombrables limes émeri géantes, plaquées sur ses façades et bien décidées à y rester, disposées dans tous les sens, avec une certaine tendance verticale néanmoins. J’avais jeté un coup d’œil à l’immeuble sur Internet avant d’arriver à Nantes, mais je m’étais dit que l’aspect des façades extérieures devait être le résultat d’une manipulation sur Photoshop, et non l’image d’un vrai lieu. A l’intérieur, la réalité était bien plus étrange : je n’avais encore jamais fait de lecture de poésie dans un magasin de meubles, et encore moins dans un lieu exposant chaises et divans de luxe aux lignes pures, tout ce qu’il y a de plus chic. C’était une excellente idée et une fois le public arrivé, lorsque nous avons commencé la lecture avec Olivier, il a semblé naturel de parler et plaisanter dans ce lieu qui n’avait plus rien de formel et qui, pour moi surtout, siégeant dans un imposant trône asiatique de feutre noir et rouge, était très confortable. Nous avons commencé notre lecture par les Poèmes déjeuner de Frank O’Hara que Joca Seria venait aussi de publier. J’aime tellement ces poèmes que j’ai regretté quelques instants de devoir les faire suivre des miens. Lorsque j’ai regardé le public, assis sur de très larges escaliers de bois qui menaient au deuxième étage, cela m’a rappelé une lecture que j’avais faite aux îles Féroé dans une bergerie vieille de 800 ans et à quel point cela avait été étrange et curieusement humain et chouette.
*
Après la lecture, les organisateurs n’ont pas laissé le plaisir retomber en offrant un verre de vin blanc et de whisky (de marque O’Hara !) et en invitant tout le monde sur le toit du bâtiment pour une vue panoramique de Nantes au coucher du soleil. Non loin, les grues semblaient faire partie de l’architecture, et au bout du regard, j’ai vu des immeubles dont les façades étaient peintes avec des couleurs primaires : on aurait dit qu’ils avaient sauté d’un tableau de Mondrian, comme Broadway Boogie Woogie. Et qu’est-ce que cette grosse tête d’éléphant fabrique là-bas ?
*
Puis, dîner à la belle Cigale, repère surréaliste où Lola de Jacques Demy a été tourné : peut-être Anouk Aimée ou André Breton s’étaient-ils assis sur ma chaise ! Et donc nous avons mangé et bu jusqu’à une heure fort tardive, bien après l’heure habituelle de mon coucher. Ces Français sont infatigables. Non, attendez, moi aussi cela m’arrivait de faire ça. Je me souviens d’avoir titubé tout autour du Louvre très tard, une nuit de 1965 avec les écrivains Harry Mathews et John Ashbery, puis m’être arrêté pour regarder un mur. Je crois qu’il s’agissait d’un mur.
*
De retour dans ma chambre, j’ai feuilleté Place Publique, apprenant, à ma surprise, qu’il y avait eu une vague d’immigration irlandaise à Nantes aux 18e et 19e siècles, les nouveaux venus irlandais finissant par s’intégrer à la population locale. Il faut que je le dise à ma belle-fille irlandaise née à quelques kilomètres de Kells, ville connue pour le livre médiéval The Book of Kells. La revue m’a aussi appris que le père de Jacques Prévert était né à Nantes, Jacques Prévert dont j’ai traduit les poèmes, sa poésie dont j’ai aussi fait l’expérience en quelque sorte : à chaque fois que je lis son poème sur l’homme qui rentre dans un café et s’assied, je revois le café au Carrefour de Buci à Paris où, il y a quarante-cinq ans, j’ai perdu de nombreuses heures à jouer au flipper. C’était aussi le café où Fernand Léger et Blaise Cendrars (que j’ai traduits tous les deux) ont descendu de nombreux verres de vin, comme Cendrars le dit dans son poème « Aux 5 coins » : « Je suis mûr / Et je tombe translucide dans la rue. »
*
Le lendemain matin, j’ai pris le train pour Angers dont le nom m’évoque d’autres choses puisque le mot « anger » en anglais signifie colère et « danger », eh bien, danger. Ajoutez à ces première appréhensions celle de devoir faire face à l’Apocalypse – en tapisserie, bien sûr. Mon esprit a continué de tisser sa propre tapisserie sur l’écheveau de la conscience, comme il l’avait fait à Nantes, car une ville n’est pas simplement un lieu avec des immeubles, des rues et des gens, c’est, pour chacun d’entre nous, un mystérieux collage cinétique de toutes les expériences que l’on peut y faire, qu’elles soient externes ou internes, y compris tous les souvenirs, désirs et idées passagères qu’elles évoquent en nous – de façon indicible ou de plein fouet – synesthésie infiniment complexe qui afflue dans nos esprits et nous transforme. Si bref fut mon séjour, à Nantes je suis devenu un peu nantais, et je suis heureux de l’être toujours un peu.
Ron Padgett
(Traduit de l’anglais
par Olivier Brossard)